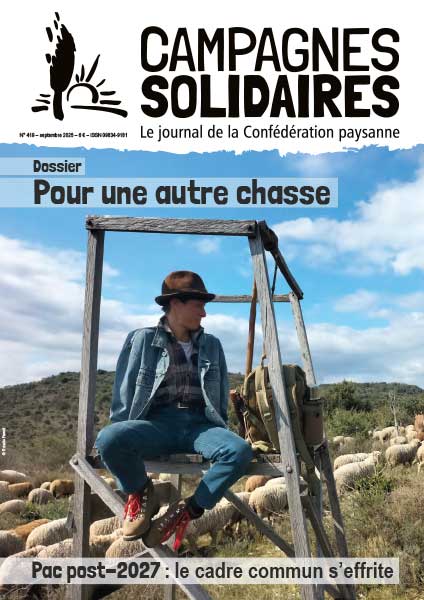Bassines de l’Aume-Couture : le projet à 12 millions d’euros pour 22 irrigants
 01.07.2020 -
01.07.2020 - Le 1er juillet 2020,
Bassines de l'Aume-Couture : le projet à 12 millions d'euros pour 22 irrigants
Le Commissaire enquêteur a donné un avis favorable à la construction des réserves de substitution d'eau du Bassin de l'Aume-Couture, suite à une enquête publique pour laquelle notre contribution n'a pas été prise en compte. Un projet brouillon et selon nous coûteux, menaçant pour le foncier, qui ne permettra pas une répartition égale des ressources en eau, ni une protection effective de ces ressources et de l'environnement.
Beaucoup de questions restent pourtant en suspens : comment se fait-il que l'Agence de l'eau subventionne ce projet, sachant qu'elle demandait des actions d'économie d'eau, et que l'hydrogéologue chargé de l'étude déclare que ces bassines conduiront à « une augmentation de plus de 40% du volume prélevé entre [les années] 2000 et 2016 »[1] ? Comment se justifient les volumes extraordinaires des réserves ? Comment ont-ils été déterminés ?
Alors que la MRAe parle du projet comme « vulnérable au changement climatique »[2] et de « risque de non-remplissage important »[3], comment se fait-il qu'on investisse autant d'argent dans des constructions inadaptées aux changements que nous nous apprêtons à vivre ? Quel est l'impact de ce projet sur le foncier ? Comment les terres qui seront utilisées pour ces bassines ont été choisies ?
Du reste, l'ASA, porteuse du projet l'évoque comme: « un projet collectif, qui fédère la quasi-totalité des irrigants du bassin »[4]. Pourtant, les agriculteurs non-irrigants (maraîcher-ere-s, éleveur-ses…) ont aussi besoin d'eau l'été, et sont les premiers à subir les restrictions d'eau. Soyons raisonnables : quand il est aussi écrit que la bassine de Saint Fraigne (réserve n°2) de 150.000 m3 n'est destinée qu'à un seul exploitant, nous ne pouvons pas parler d'intérêt collectif, surtout lorsque 70% du projet est financé par de l'argent publique.
Pour la Confédération paysanne, ce projet va à l'encontre des attentes des citoyen-ness par rapport à l'alimentation, l'agriculture et l'environnement. Celui-ci va également à l'encontre de la raison au regard des enjeux de société sur le foncier, l'installation, l'emploi agricole et rural et la préservation des ressources. Pourquoi faut-il puiser toujours plus de ressources et privilégier les intérêts particuliers ? Si l'argent publique doit être investi, c'est pour une transition vers l'agroécologie et des méthodes culturales économes en eau.
En tant que syndicat représentant l'agriculture paysanne : plébiscitée par les citoyen-ne-s et qui démontre qu'une autre agriculture est possible, nous affirmons notre ferme opposition au projet et regrettons que la Préfecture n'ait pas publié notre avis.
Contacts:
Agnès Rousteau Fortin, co-porte-parole : 06 80 52 00 13
Jérémy Hamon, co-porte-parole : 06 52 82 17 07
[1]Rapport de l'hydrogéologue chargé de l'étude, p.13
[2]AVIS n° 2019APNA142 rendu par la Délégation de la Mission Régionale d'Autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine.
[3]AVIS n° 2019APNA142 rendu par la Délégation de la Mission Régionale d'Autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine.
[4]RNT, p.6